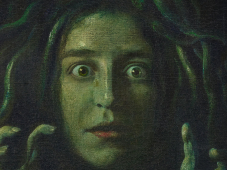La Lecture
Description de l'oeuvre
Fortement ancré dans la vallée de la Marne, c’est dans les environs de Charly-sur-Marne où il s’établit à partir de 1886 que Buland trouve les modèles de ses tableaux, principalement auprès du monde paysan et ouvrier qu’il fréquente.
Comme dans le tableau de 1899 titré « Procession », dans lequel on reconnaît aisément l’intérieur de l’église à Charly-sur-Marne (aujourd’hui conservé au musée Villa Médicis à Saint Maur des Fossés) et dans « Offrande à la Vierge » de 1879 (aujourd’hui conservé au Musée Malraux au Havre), la femme porte la coiffe de sa région. Elle a stoppé son ouvrage de broderie pour écouter sa fille lui faire la lecture.
Suivant la tradition classique, Eugène Buland joue de multiples contrastes pour captiver notre attention : la jeunesse et l’âge mûr, la robe rose et la tenue endeuillée, le travail manuel et le travail intellectuel. La succession de plans horizontaux et verticaux apporte une dynamique importante à cette représentation qui revêt également une certaine immobilité que l’on retrouve dans ses portraits de cette période et qui les rapprochent souvent de la photographie.
Mais ici, la femme et sa fille ne semblent pas poser comme c’est parfois le cas dans certains tableaux du peintre. Elles sont plutôt saisies sur le vif, comme si on pénétrait dans l’intimité de leur intérieur et qu’on devenait spectateur de l’instant.
A l’arrière-plan, on distingue quelques objets en verrerie, disposés sur le rebord de la cheminée, dont un vase sur pied également présent dans le tableau de 1898 « Une bonne trouvaille » aujourd’hui conservé au Musée Unterlinden de Colmar.
Notre tableau s’inscrit dans l’évolution de la peinture de Buland à l’orée du XXe siècle. Le peintre délaisse peu à peu la vision totalement frontale que l’on trouve dans « Le repas du jardinier » pour évoluer vers une représentation toujours extrêmement réaliste, mais plus douce, comme dans le portrait de son fils Jean-Paul en 1902 saisi, là aussi, dans un moment de lecture.
75008 Paris, France
Le samedi de 14h à 19h